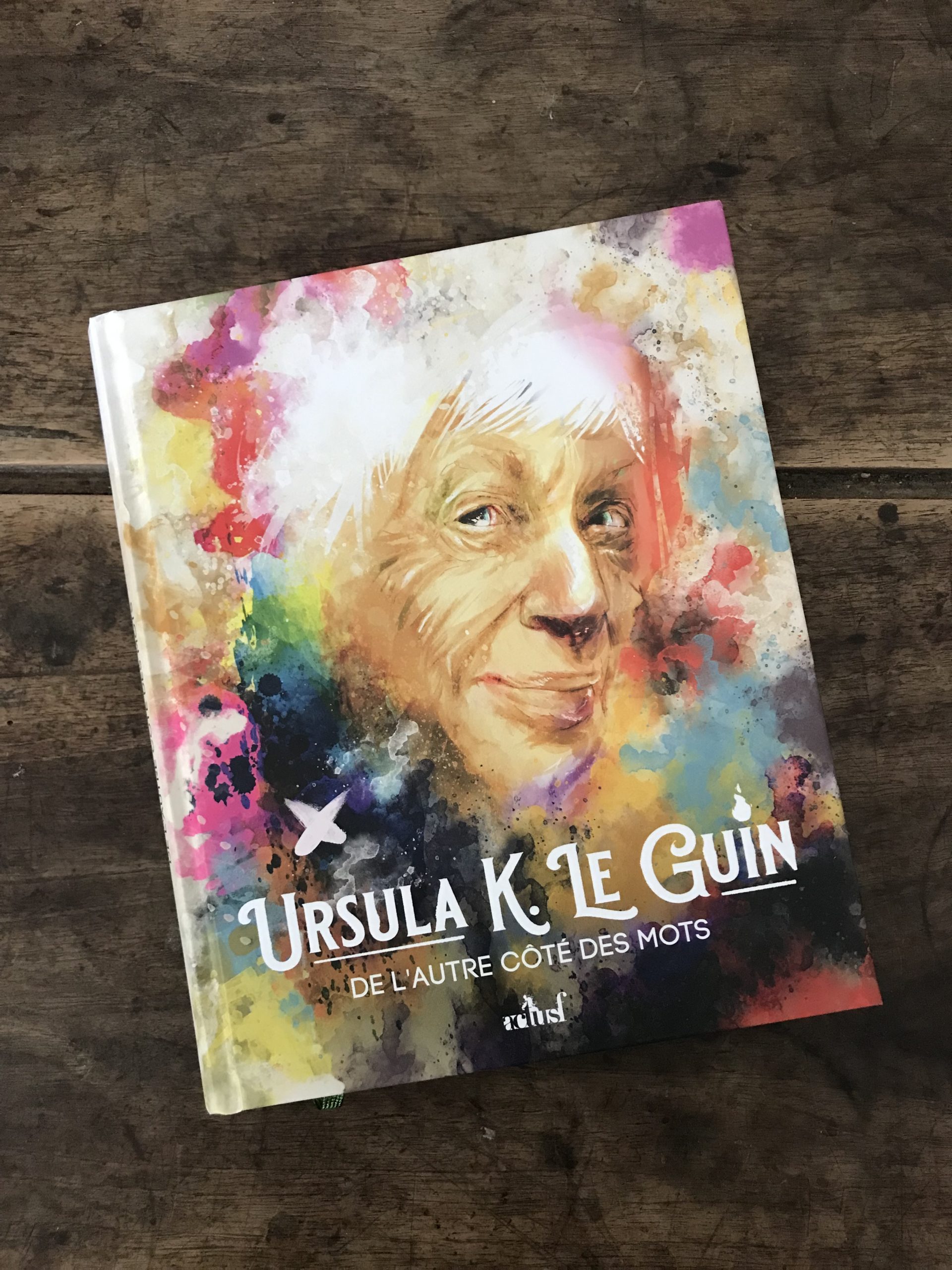Temps de lecture estimé : 3 min
Le voilà de retour. Je n’étais pas pressé qu’il repointe son nez, et qu’il insiste en plus. Mais puisque tu es là, salut à toi alors. Pas besoin de te dire de faire comme chez toi, n’est-ce pas ? Fichu compagnon d’écriture.
Il est revenu : le doute.
Ça commence par l’intrigue : est-ce que je vais dans la bonne direction ? Ça s’étend au bouquin entier : est-ce que ça a du sens de l’écrire ? Jusqu’à tout paralyser : est-ce que ça a du sens d’écrire des romans ? d’écrire tout court ?
« À quoi tu sers ? me susurre l’intrus. Qu’est-ce que tu fous, quand certains sauvent des vies, éduquent la jeunesse, trouvent des solutions aux problèmes du monde ? »
Mes deux premiers romans n’ont pas vraiment marché… faut-il vraiment se remuer les tripes pour en écrire un troisième, un de plus dans une production littéraire déjà pléthorique ?
Déjà, l’instinct de survie se réveille en moi : au fond, ce n’était peut-être qu’un problème de diffusion, de communication, d’image. Dans le monde actuel, il faut com-mu-ni-quer pour espérer le succès ; il faut se faire connaître, se faire voir, se faire désirer. Voir et être vu, lire… et être lu ?
Si ces deux romans n’ont pas marché, bien sûr, c’est que je n’ai pas adopté la bonne stratégie, la parfaite mise en scène de soi que tout artiste d’aujourd’hui doit offrir à son public. Trop tard, ce site Internet, ce compte Instagram, ces mises à jour LinkedIn ! Pas assez affûtées, ces manœuvres numériques, pas assez de stories, de selfies, de sexy ! « Comment n’es-tu pas encore sur Youtube, pauvre naïf ? »
Il faut apprendre à séduire les algorithmes, s’équiper pour imposer son meilleur profil, sélectionner sa langue et choisir sa niche : « À qui t’adresses-tu ? Quel est ton personnage ? Clarifie ta cible, bon sang ! »
Il faut affirmer qui l’on est, être fier de ce que l’on fait, et savoir vendre tout ça. Impossible d’aller contre son époque : il faut endosser son devenir mercatique.
« À moins que… le problème, ce soit ce que tu écris, kiki. » reprend mon hôte indésirable. « Vois comme tu rames à produire quelque chose dont tu serais satisfait ! »
Et je ne peux que m’incliner. Oui, ces heures à tenter, à hésiter, à avancer à tâtons pour… pour quoi, au fond ? Quelque chose qui a déjà été fait par d’autres sans doute, avec plus de sensibilité, d’intelligence, d’élégance. Ou bien un texte qui passera à côté de son sujet. Ou pire encore, une fiction gentillette, inoffensive. Ou incompréhensible. Il y a tant de façons de rater !
Une nouvelle angoisse émerge ces jours-ci, et mon doute me l’exprime sans détours : « Tu n’es pas assez intelligent pour aborder ces questions-là ! »
Hé oui : je voudrais écrire quelque chose qui n’est manifestement pas à ma portée. Je cherche à utiliser des concepts que je ne parviens pas à comprendre, et que je ne maîtriserai certainement jamais. Je voudrais aborder de front pour ce texte un nombre de dimensions supérieur à celui que mon cerveau parvient à traiter. J’atteins la limite.
Est-ce un effet de l’âge ? Ce serait la fin de l’énergie de la jeunesse, de la confiance en soi, de la foi en la possibilité de tout réussir, de tout apprendre, de tout changer ?
Au fond, même dans ce petit article, je ressens la limite. Je voudrais l’émailler de citations philosophiques pertinentes – Cioran, Schopenhauer, Nietzsche ? – mais puisque je ne suis pas plus savant que philosophe, il me faudrait aller les piocher dans un annuaire de citations en ligne en tapant les mots clés « échec », « doute » ou « médiocre ». Je préfère ne pas.
La solution serait-elle de revendiquer ce personnage de non-savant, de douteur bancal, pour tenter de faire de ma faiblesse une force, de ma honte une victoire ? Telle est la véritable question, au fond : que serait la victoire ? Quels paramètres seraient ceux du succès ? À partir de quoi, de comment, de combien pourrais-je établir qu’un roman a marché ? Ce seuil n’existe pas : notre besoin de consolation est impossible à rassasier, comme l’a révélé Stig Dagerman.
Mais l’écrivain suédois dévoile aussi « tout ce qui m’arrive d’important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu : la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l’on donne à un enfant, le frisson devant la beauté ». Toutes ces choses que la situation actuelle nous empêche de vivre librement, et qui forment cependant la matière véritable d’une vie, en même temps que sa raison d’être ; ce qui fait taire, dans la ferveur de l’instant, le doute et l’angoisse, la peur, la mort.
C’est vrai : toi, mon ami, l’inconnue qui me sourit, l’être si lointain mais si proche, je te tiens dans mes bras et tout est oublié. Je peux écrire et aimer à nouveau, vivre sans crainte pour quelques temps encore. Ta douceur est mon remède, ton rire ma force renouvelée.
En ces temps où je ne peux t’étreindre, j’apprends en attendant à accepter le doute. De mon existence, j’embrasse l’insignifiance.