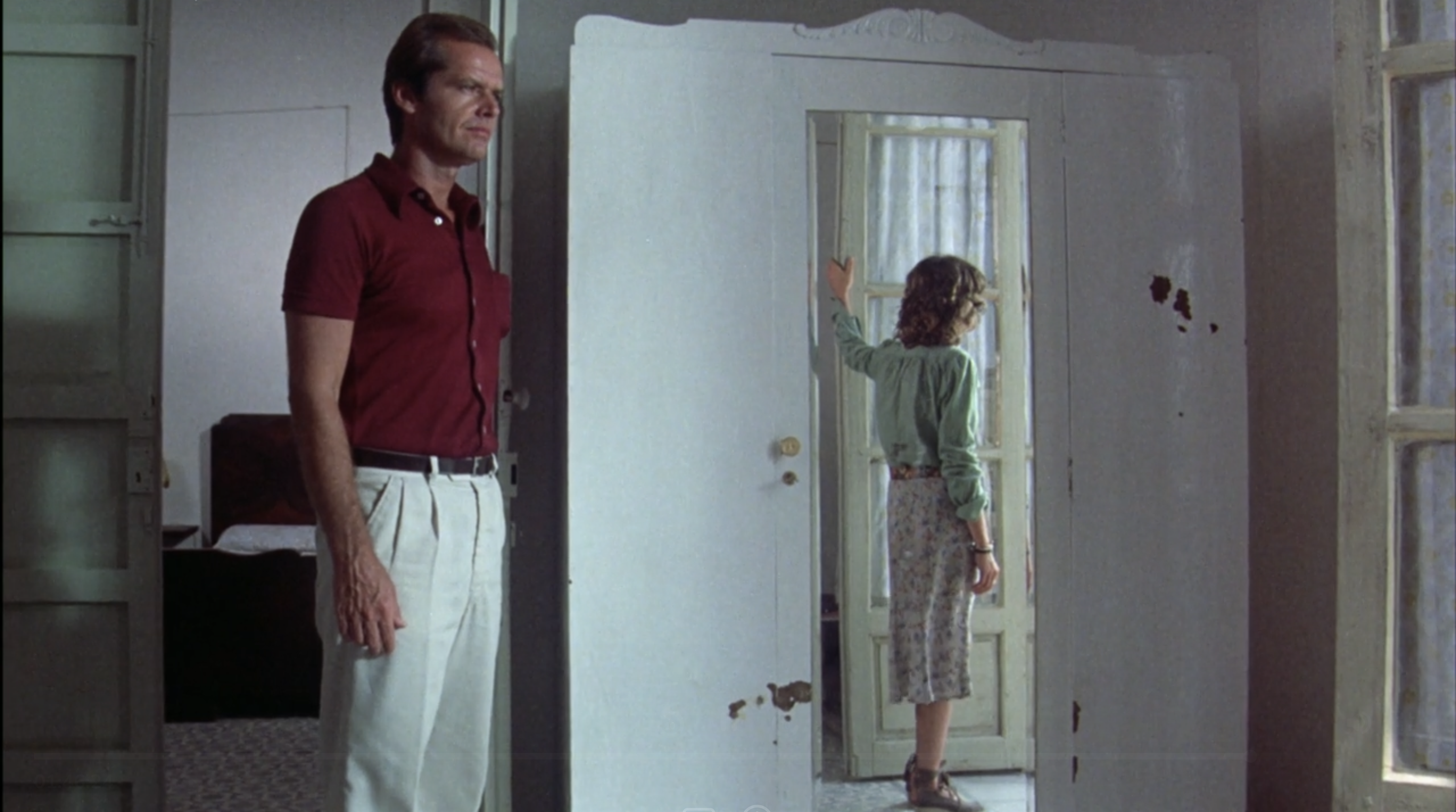La fin du quarante-deux
Aujourd’hui, j’ai 43 ans.
L’année dernière, cela m’avait amusé de constater que j’entrais enfin dans l’ère du 42, ce fameux nombre qui serait, selon Douglas Adams — dont la « trilogie en cinq tomes » du Guide du voyageur Galactique a été ma porte d’entrée dans la science-fiction — la réponse à « la grande question sur la vie, l’univers et le reste ». Je voyais dans cette entrée un clin d’œil aux tourments de la quarantaine et la possibilité d’enfin arriver à mieux comprendre ce que j’étais, ce que je voulais, et les clés de mon rapport aux autres.
Un an après, je me rends compte que c’est tout l’inverse. Les questions sont plus nombreuses que jamais, mais ce qui a changé en moi, c’est l’approche. Ce texte en est un exemple : jusqu’à présent, j’avais toujours rechigné à dévoiler publiquement des aspects de ma vie privée, de même qu’à affirmer des points de vue tranchés. C’était le fruit de mon éducation, qui insistait sur la pudeur et le fait de ne pas s’exposer. C’était aussi l’expression d’une angoisse : se dévoiler, n’était-ce pas prendre le risque de déplaire ? C’était enfin le signe d’une mégalomanie certaine : « Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous », et comme c’était évident que j’allais finir par être célèbre, on allait irrémédiablement me reprocher mes positionnements passés ou me harceler avec les informations personnelles que j’aurais laissé fuiter.
Ce mouvement d’acceptation de l’expression de soi s’est accompagné d’une réflexion sur la manière de le faire. Je n’ai jamais vraiment aimé les réseaux sociaux et n’ai jamais réussi à trouver la façon d’y être bien (y en a‑t-il seulement une ? leur concept n’est-il pas justement d’entretenir un malaise qui pousse à y revenir sans cesse ?)En plus de la question des algorithmes qui en sont devenu le principal problème, l’absence de personnalisation possible de l’ergonomie et de l’interface de ces outils, sans compter leur multiplication et leurs codes propres, m’ont finalement persuadé d’y renoncer pour ne garder qu’un seul canal, que je peux définir à ma guise : ce site internet.
Si vous lisez ce texte sur Mastodon, c’est que ce réseau social n’est pas comme les autres : il fonctionne de façon décentralisée, et chacun y parle « de chez lui » (et non pas dans l’immense hall marketé d’un centre commercial de chez Meta, par exemple). Grâce à WordPress, j’ai pu faire de mon site une instance Mastodon, et chaque nouveau texte publié sur le site est automatiquement diffusé sur le réseau, tout en restant sur mon serveur. Plutôt que de consacrer du temps et de l’énergie à m’éparpiller partout, je me concentre sur l’écriture, le « contenu » comme on dit maintenant.
Le lâcher-prise
Dans l’écriture, comme dans le dévoilement de moi, j’y allais jusqu’à peu avec parcimonie, avec beaucoup de réflexion en amont et surtout une immense dose de contrôle.
Il fallait que chaque partie, chaque paragraphe, chaque phrase, et même chaque signe (ceols qui ont lu Le Point aveugle en savent quelque chose) soit savamment peséc, mûric, réfléchic de façon approfondie pour pouvoir être, à la fois, la concrétisation exacte de la pensée, et la forme la plus adaptée à sa transmission (ce que, bien sûr, ol n’était jamais vraiment). Cela demandait une grande concentration, et donc à chaque fois un temps dédié et un environnement adapté. Mais c’était surtout un grand frein à l’action, et la liste des idées ou envies restées en coulisses sur le bloc-notes n’a cessé de s’allonger au fil des années.
Il y a quelques semaines, j’ai déjeuné avec des amics scénaristes, des compagnums de plume rencontrécs lors d’une aventure commune il y a une douzaine d’années. Chacum a tracé sa route dans sa direction singulière, mais nous ne manquons pas de nous revoir deux-trois fois l’an pour partager nos expériences, nos joies et nos désillusions ; pour recevoir un regard autre mais avisé sur nos trajectoires parfois pleines de doutes (surtout la mienne).
Lors de ce repas, je confiai ma difficulté à écrire le roman en cours, malgré la bourse du CNL reçue. Je pensais que la bourse serait un moteur suffisant pour dépasser les blocages, un tremplin à même de me lancer dans l’aventure, mais je restais pétri d’incertitudes et coincé dans des questions de forme et de fond qui me paraissaient insolubles. C’est alors que la réponse jaillit de mes amics : écris le plus vite possible, et surtout, autorise-toi à écrire un mauvais roman ! Ça ne t’empêcheras pas de le reprendre ensuite si tu le veux, mais au moins tu auras la satisfaction d’avoir abouti quelque chose… et tu pourras toucher le reliquat de la bourse — dont le versement se déclenche lors de la soumission du manuscrit terminé !
Je me lançai donc dans l’écriture sans regarder en arrière ni m’appesantir sur chaque phrase, pour tenir l’objectif quotidien que je m’étais donné. J’ai rapidement atteint le plaisir de pouvoir écrire un chapitre quotidien. Mais surtout, j’ai découvert un autre type d’écriture, plus fluide, plus libre. Sans doute plus personnel, aussi. En abandonnant la volonté de maîtriser ce qui peut sortir, je laisse une voix plus sincère s’exprimer. Et sans doute plus lisible, aussi. Mais pas seulement. Je me délaisse également d’un penchant à la complexification.
L’art du non-retournement
J’ai vu Juré numéro 2, le dernier film réalisé par Clint Eastwood, écrit par Jonathan Abrams. La réalisation est honnête, classique pourrait-on dire, sans éclat ni ingéniosité mais au service de l’histoire et surtout de ses personnage, à commencer par ce fameux juré numéro 2. Celui-ci est un homme d’une trentaine d’années, désigné comme juré d’une affaire criminelle. Il cherche à se faire remplacer : sa femme est sur le point d’accoucher, et il ne veut pas manquer la naissance ; en vain. Il doit donc juger avec onze autres personnes le petit-ami d’une femme qu’on a retrouvé morte dans le ravin jouxtant une route, non loin du bar où ils s’étaient publiquement disputés, et d’où elle était partie à pied, peu avant que lui ne prenne sa voiture pour la rattraper. Or, le protagoniste juré se rend compte rapidement que l’endroit où a été retrouvée la victime est précisément celui où, ce soir-là, il a pensé avoir heurté un cerf… Il est donc persuadé d’être le coupable, et que l’homme qu’il juge (et que tous les autres jurés, comme la procureure, pensent coupable) est en fait innocent.
Ces informations arrivent très rapidement, au bout de quelques minutes. Je me suis alors dit : comment vont-ils tenir la longueur ? Quelles vont être les révélations qui vont relancer l’intrigue ? Je m’attendais à ce qu’un changement de perspective important se révèle : finalement, ce n’est pas lui le responsable de la mort de la jeune femme, on va apprendre autre chose, etc. Mais… non.
Ce fut une leçon d’écriture pour moi : pas besoin de retournement supplémentaire, de révélation en plus. Il faut juste muscler au maximum la prémisse, le concept, pour en tirer toute la sève. Ici, un homme appelé à condamner un accusé de meurtre qu’il est le seul à savoir innocent, puisque c’est lui le responsable de la mort.
Le protagoniste est dans un dilemme fort : il ne peut pas se permettre de se dénoncer, parce qu’il ne peut pas laisser sa femme élever seule leur fille à naître (ils ont déjà perdu des jumeaux d’une précédente grossesse), mais il ne peut pas non plus accepter qu’un innocent soit condamné, qui plus est un bad guy repenti qui affirme avoir changé en rencontrant sa petite amie, parce que lui-même est un alcoolique repenti… sauvé par la rencontre avec sa femme. Et le soir de l’accident, c’est justement cet enjeu d’alcool et de bébé qui est au paroxysme et le pousse à être sur les lieux alors qu’il ne devrait pas : c’est le jour anniversaire où devaient naître ses jumeaux décédés. Pour supporter ce souvenir traumatique, il décide de mentir à sa femme et fait un détour pour s’arrêter commander une pinte (qu’il ne boira finalement pas) dans un bar… celui précisément où le couple se dispute.
Ce n’est pas la multiplication des événements qui rend l’histoire si touchante et prenante, c’est leur profondeur grandissante (un peu comme une fractale). Contre la complexité narrative, c’est la complexité émotionnelle et la cohérence de l’ensemble qui apportent tension dramatique et satisfaction lors de sa résolution (même ouverte, comme dans le cas du film d’Eastwood).
À une époque où le monde vit de plus en plus dans une succession d’annonces, d’événements contraires, où tout change tout le temps et dans tous les sens, j’ai besoin, comme beaucoup de monde sans doute, d’apprendre l’art du non-retournement. De me désintoxiquer des notifications, des infos en continu, des « contenus » disponibles à n’en plus finir, pour retrouver la prémisse en moi, le fil conducteur à approfondir, qui donne du sens à l’existence.
Voici donc la leçon de cette année quarante-deux écoulée, et la question qui demeure, au niveau personnel comme professionnel ; ce qui m’apparaît comme la question pour trouver toutes les réponses :
Comment lâcher mieux pour approfondir plus ?
Et ça nous mène à la danse… mais ce sera pour un autre texte !